Désobéissance civile et railleries contre Bédié: Un Chercheur en science politique recadre les militants du RDR-RHDP
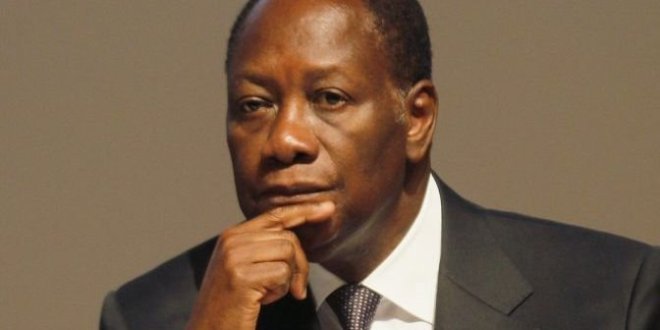
Désobéissance civile et railleries contre Bédié: Un Chercheur en science politique recadre les militants du RDR-RHDP

| LA DESOBEISSANCE CIVILE, C’EST QUOI, AU JUSTE ? C’est connu : les Ivoirien(ne)s aiment les nouveaux mots. Il n’est donc pas étonnant que le terme de désobéissance civile, employé par SEM Henri Konan Bédié, lors de la rencontre de l’opposition significative du dimanche 20 septembre 2020, ait immédiatement fait le buzz sur les réseaux sociaux et soit actuellement sur toutes les lèvres. Mais à entendre ou à lire les railleries, quolibets et sarcasmes des habitants de la case, on comprend qu’une explication du concept serait la bienvenue. Je me propose, ici, de définir le concept, de préciser ses traits caractéristiques et d’en donner des exemples précis tirés de son histoire. QU’EST-CE QUE LA DESOBEISSANCE CIVILE ? Si la paternité du terme est attribuée au philosophe américain Henry David Thoreau (1817-1862), qui l’a conceptualisé dans un essai éponyme paru en 1849, les philosophes John Rawls et Jürgen Habermas en demeurent les références définitionnelles. Dans La Théorie de la Justice (1971) John Rawls (1921-2002) définit la désobéissance civile comme « un acte public, non violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement. En agissant ainsi, on s’adresse au sens de la justice de la majorité de la communauté et on déclare que, selon une opinion mûrement réfléchie, les principes de coopération sociale entre des êtres libres et égaux ne sont pas actuellement respectés ». Pour Jürgen Habermas : « La désobéissance civile inclut des actes illégaux, généralement dus à leurs auteurs collectifs, définis à la fois par leur caractère public et symbolique et par le fait d’avoir des principes, actes qui comportent en premier lieu des moyens de protestation non violents et qui appellent à la capacité de raisonner et au sens de la justice du peuple. » Sans rentrer dans la subtile polémique sémantique opposant les deux penseurs, la désobéissance civile (civil disobedience), qu’il ne faut strictement pas confondre avec la désobéissance civique, peut se définir comme une forme de résistance passive qui consiste pour un groupe ou un mouvement, dont les membres sont prêts à encourir les peines légales prévues, de refuser de manière assumée et publique d’obéir à une loi, un jugement, une politique ou un pouvoir jugé injuste ? de manière pacifique. La désobéissance civile s’apparente donc à une forme de résistance sans violence. Elle ne doit donc pas être confondue avec l’objection de conscience qui est un acte individuel et dont le plus symbolique exemple est le refus de circonscription dans l’armée américaine par Muhammad Ali, le légendaire champion de boxe poids lourd, farouchement opposé à la guerre du Vietnam. Il est important de préciser que l’opposition à la loi qui est inhérente à la désobéissance civile se faisant dans une paradoxale fidélité à une loi considérée supérieure, il n’y a pas de violence dans l’esprit de la désobéissance civile. Celle-ci étant plutôt le fait de l’État, le seul qui dispose d’une « violence légitime » dixit Max Weber. QUELS SONT LES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA DESOBEISSANCE CIVILE ? A partir de ces définitions se dégagent six éléments permettant de caractériser une action de désobéissance civile. Le premier élément concerne la commission d’une infraction consciente et intentionnelle. En effet, l’acte de désobéissance doit violer une règle de droit positif. Cet élément permet de distinguer classiquement deux formes de désobéissance civile. On parle de désobéissance directe, lorsque l’infraction porte directement sur la norme contestée. L’exemple d’école en la matière concerne les campagnes de désobéissance civile lancées par Martin Luther King, aux Etats-Unis, dans les années 50, qui visaient à faire occuper par les noirs les espaces légalement réservés aux blancs. Le refus actuel de l’opposition ivoirienne d’accepter la décision du Conseil constitutionnel et le processus électoral tel que mené par le pouvoir en place s’apparente à une désobéissance civile directe. A contrario, lorsque la norme violée n’est pas celle directement contestée, on parle alors de désobéissance civile indirecte. Les sit-in sont considérés comme l’exemple-type. Ils ne visent pas à contester le code de la route qu’ils violent pourtant, mais une autre loi au centre des préoccupations de leurs organisateurs. Une autre distinction moins adoptée consacre le départ entre désobéissance civile strictement passive et désobéissance civile plus ou moins offensive. On admet que si l’existence d’une infraction est déterminée a priori par le juge, un acte est constitutif d’une désobéissance civile, lorsque ses auteurs prennent le risque de le commettre, alors même qu’aux yeux de l’opinion publique et à ceux des autorités, il est généralement tenu pour une infraction. Le deuxième élément se traduit par un acte public. Tout en différenciant la désobéissance civile de la désobéissance criminelle, qui ne prospère que dans la clandestinité, la publicité de l’acte de désobéissance civile vise à lui donner une valeur de symbole. Il s’agit d’atteindre une audience aussi large que possible, afin de sensibiliser le public à la cause défendue. Ce qui est recherché, c’est le retentissement, la médiatisation – les internautes diraient le buzz – permettant d’influencer l’opinion publique. Pour certains auteurs partageant la ligne de Gandhi, la publicité est une exigence qui veut qu’on communique, à l’avance, aux autorités compétentes, les actions futures de désobéissance civile. Le troisième élément porte sur la réalisation collective de l’acte. En effet, l’acte de désobéissance civile s’inscrit, par principe, dans un mouvement collectif ou à vocation collective, ce qui permet de la distinguer de son pendant individuel qu’est l’objection de conscience, ainsi que souligné plus haut. La désobéissance civile est donc par nature une action collective, mais rien n’empêche que le sursaut moral d’un individu ne finisse par mobiliser un courant plus large qui pourra, alors, être qualifié de désobéissance civile. On note, par exemple, que le refus de payer l’impôt qui permettra à Henry David Thoreau de conceptualiser la désobéissance civile, était un acte individuel. Le quatrième élément se rapporte à l’utilisation de méthodes pacifiques. L’action pacifique qui caractérise la désobéissance civile la distingue des formes violentes de la résistance telles que la révolution, l’insurrection ou la rébellion. La désobéissance civile vise à appeler aux débats publics et, pour ce faire, elle en appelle à la « conscience endormie » de la majorité plutôt qu’à la force. Le cinquième élément est que l’action de désobéissance civile doit être réalisée par ses auteurs en acceptant les éventualités d’une sanction. Ainsi, que ce soit Thoreau, Gandhi ou Luther King, chacun, en défiant l’autorité de la loi, était prêt à subir la rigueur des sanctions qu’elle prévoyait, y compris l’emprisonnement. Enfin, le dernier élément est que l’action réalisée doit faire appel à des « principes supérieurs » à l’acte contesté pour justifier la violation d’une norme. Ce trait est généralement considéré comme le plus important, puisque c’est lui qui à la désobéissance civile sa légitimité. En d’autres termes, c’est l’existence de principes supérieurs qui confère une certaine légitimité à l’acte de désobéissance. Ainsi, la Constitution ivoirienne étant un acte largement supérieur à la décision du Conseil constitutionnel qui valide la candidature illégale d’Alassane Ouattara tout en invalidant, sur de fallacieux motifs, celles de nombreux opposants, la désobéissance civile de l’opposition à cette décision injuste se justifie. Mais, les principes supérieurs en question ne sont pas que légaux. La désobéissance civile peut faire appel à des principes religieux ou moraux, par exemple le respect de la parole donnée au peuple qui impose que son auteur ne puisse se parjurer. A cet égard, la désobéissance civile, loin d’affaiblir les institutions, pourrait bien au contraire contribuer à les renforcer, d’autant qu’elle engendre une compréhension plus claire de leurs idéaux fondateurs, sans oublier la promotion de la participation citoyenne au processus normatif. EVOLUTION DE LA DESOBEISSANCE CIVILE ET QUELQUES EXEMPLES HISTORIQUES Les actes de désobéissance civile sont légion à travers l’histoire. De l’antiquité grecque, l’exemple le plus connu de désobéissance à l’arbitraire du pouvoir est celui d’Antigone, héroïne du roman de Sophocle, écrit en 439 avant Jésus-Christ. La désobéissance civile est au cœur du christianisme, dès ses origines. En effet, la Bible établit une distinction entre la loi des hommes et la loi ou les commandements de Dieu. En témoigne la célèbre formule de Jésus-Christ : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Au Moyen-Age, le théologien Thomas d’Aquin alla jusqu’à légitimer la désobéissance aux lois humaines en affirmant qu’il « vaut mieux obéir à Dieu qu’aux Hommes ». Considérant que le droit divin est un droit naturel, fondé sur des principes universels et immuables, contrairement aux lois de la société, il appartient aux lois humaines d’être conformes à ce droit naturel. A défaut, pour Thomas d’Aquin, si une loi humaine s’éloigne de cette loi immanente et éternelle, devient injuste et il est donc légitime de ne pas la respecter. La marche du sel, en Inde, constitue le premier mouvement contemporain de la désobéissance civile connu. Elle fut initiée par l’avocat indien Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), théoricien du satyāgraha, la résistance à l’oppression par la désobéissance civile. Plus récemment, le célèbre pasteur baptiste afro-américain Martin Luther King (1929-1968), qui s’inspirait à la fois de de Jésus-Christ et Gandhi, initia le boycott des bus de Montgomery, dans l’Alabama, en 1955, pour protester contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis, notamment dans le transport. Pour sa lutte non-violente en faveur de l’égalité des droits, il obtint, en 1964, le Prix Nobel de la Paix. Gandhi et Luther King demeurent les figures historiques, universelles et emblématiques de la désobéissance civile. Après la Seconde Guerre mondiale, lors du procès des anciens nazis, à Nuremberg, la question : « jusqu’à quel point le principe de légalité doit prévaloir sur celui de justice ? », fut au cœur des débats. Aujourd’hui, la désobéissance civile connaît un nouvel essor face à la crise environnementale, notamment avec l’avènement du concept de développement durable. La désobéissance civile est désormais utilisée comme un outil de lutte contre le changement climatique. Elle ajoute l’objet « défense de l’environnement » à celui plus traditionnel de lutte pour l’égalité des droits. Son utilisation par les milieux écologiques a commencé avec des actions comme celle de Greenpeace contre le nucléaire, dans les années 1970, ou les faucheurs d’OGM conduits par José Bové, dans les années 2000. Mais au-delà de l’évolution de son objet les mouvements contemporains de désobéissance civile, à l’instar des Gilets jaunes, sont novateurs, en ce qu’ils s’inscrivent dans une perspective internationale et font usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication, dont les réseaux sociaux. KOUAME Yao Séraphin Maire et délégué PDCI-RDA de Brobo Chercheur en science politique |

Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat pré-établi, la reprise des articles de africanewsquick.net, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s’expose à des poursuites.
En savoir plus sur AFRICANEWSQUICK
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





Vous devez être connecté pour poster un commentaire.